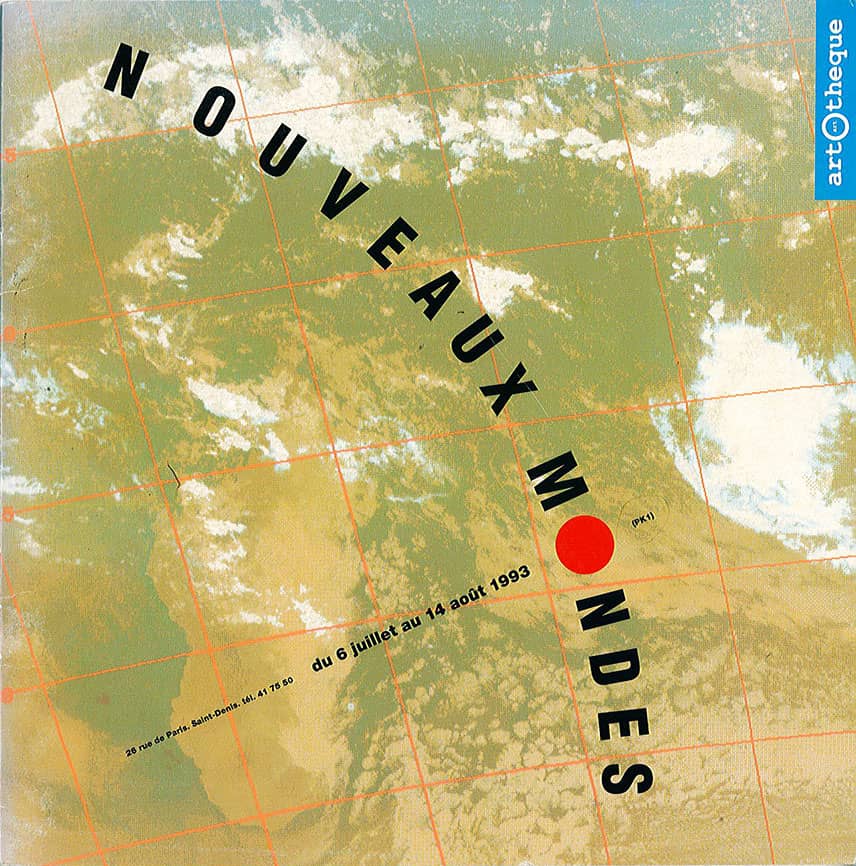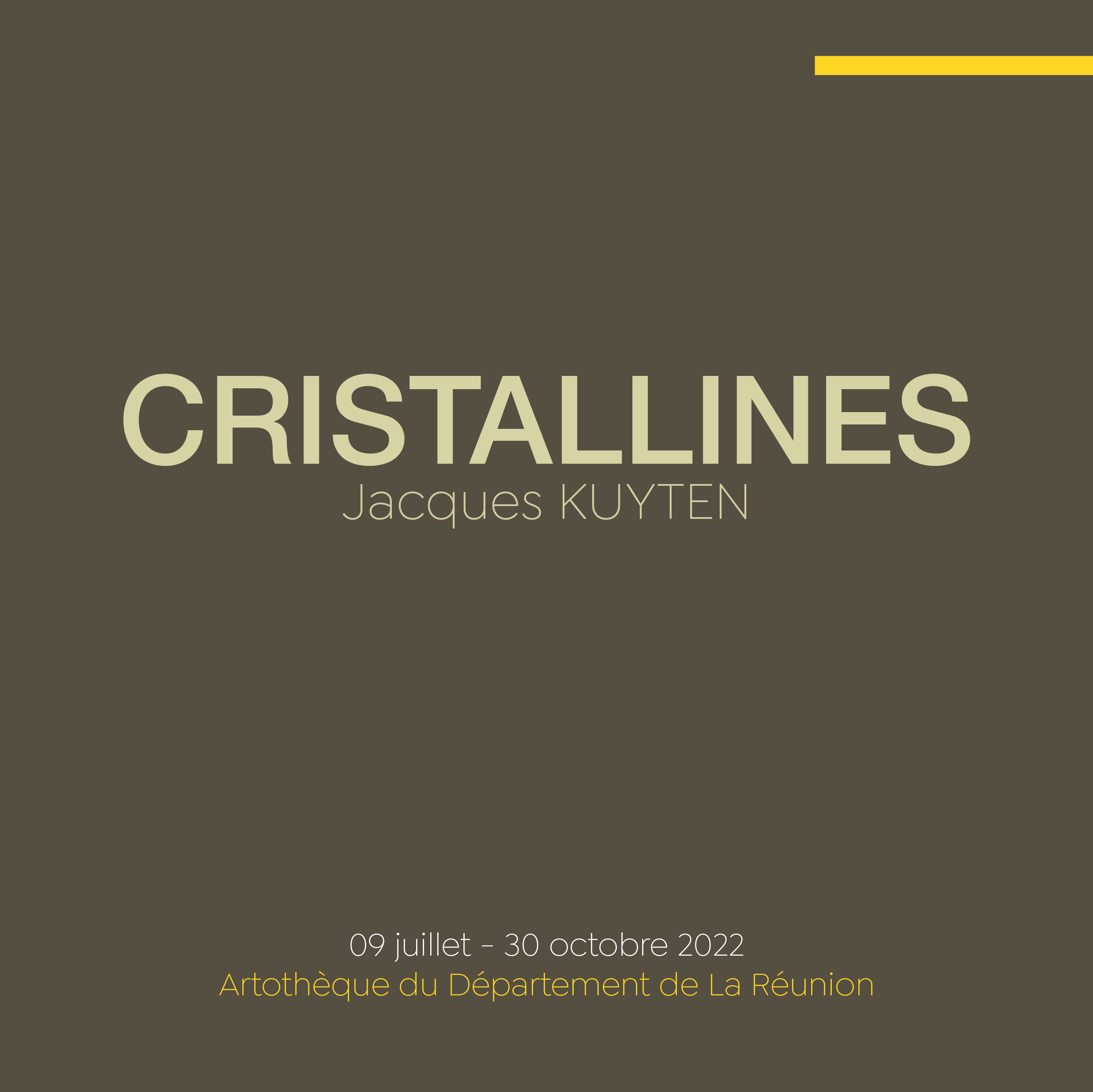« NOTES BLEUES – COULÉE DOUCE » : CONJUGUER LES CORPS SUR LA POINTE DES PIEDS
« Tu peux me supporter ? Avec tes bras, avec ton dos.
Combien de temps ça peut durer ?
Et moi est-ce que je peux.
Rester la tête collée à ton épaule. Une demi-heure.
Se traîner ensemble, s’étaler dur les sols.
Est-ce qu’on peut se tenir debout ensemble ?
Combien de temps ça peut durer ?
Et si tu respires très lentement, très fort, est-ce que tu peux me faire glisser ?
peut-on couler comme ça ? »[1]
Myriam Omar Awadi est une artiste plasticienne incontournable de la jeune création contemporaine. « Artiste de l’entre-deux cultures », comme elle se définit elle-même avec une certaine ironie, ses racines comorienne et française viennent irriguer une production décomplexée qui interroge et ré-interprète traditions et rituels dans des performances et des installations où se mêlent le conceptuel, le poétique et le spectaculaire. Au cœur de son travail, et comme situé également dans un entre-deux, entre visible et invisible, présence et absence, acte de création et non-acte, In(acte) : la figure de l’artiste. Celle qui brode ou dessine inlassablement des petites fleurs bleues, coud ensemble des pelures de clémentines pour fabriquer une peau de chagrin, celle qui déclame de la poésie ou chante des chansons populaires dans un orchestre vide, fait des conférences et des discours sur les oeuvres, ou celle qui, vêtue de la lumière réfléchissante des sequins, tourne sans fin comme une boule à facette sur la scène des comédies humaines. Sous le voile des gestes quotidiens et insignifiants qu’elle donne à voir, elle met en forme une réflexion politique aiguisée sur les vulnérabilités et les résistances, à travers notamment une observation critique du milieu de l’art contemporain, ses codes, ses rituels, ses logiques de cour et ses luttes de pouvoir. Très engagée sur les questions féministes et décoloniales, Myriam Omar Awadi a enseigné les pratiques performatives à l’École Supérieure d’Art entre 2013 et 2020, elle est membre du collectif La Box/Run Space, et son travail est régulièrement diffusé au sein d’expositions, de foires et de résidences en Europe, dans les pays de l’océan Indien et à l’international.
« Notes Bleues – coulée douce » est une aquarelle sur papier de format moyen, qui installe deux couples de danseurs dans un espace blanc indéterminé. Aucune ligne d’horizon, aucune verticale ne viennent structurer le champ dans lequel les personnages dansent sur la pointe des pieds, le corps comme suspendu. Aucune ombre portée ne les rattache au sol. Ils semblent flotter, occupant un espace relativement restreint dans une composition où, à la manière des ukyo-e, « images du monde flottant », le vide a une présence plastique considérable. Un des deux couples —un homme et une femme—, se trouve au centre de la composition. Non loin, sur la gauche, ce sont deux femmes qui dansent, et leur mouvement confère à l’ensemble une sorte de légèreté dans un équilibre fragile. Leurs habits sont dessinés avec le même motif de petites fleurs bleues. « Ils sont en pyjama, écrit l’artiste. Des pyjamas et des robes de chambre d’un tissu fluide, bleu ciel. Un coton léger recouvert de petites fleurs bleues »[2].
Ils n’ont pas de tête, donc pas de parole, d’ouïe, de vue, ni d’odorat. Pour Myriam Omar Awadi, cette absence catalyse un ensemble de questions liées au corps social et ce qui nous y rattache : « Est-ce qu’ils sont sans tête parce qu’ils sont devenus zombies ? Ont-ils ont été zombifiés par les espaces de conditionnement que sont les espaces sociaux ou est-ce que justement le fait qu’ils soient sans tête montre qu’ils sont ouverts, qu’ils sont des corps connectés ? Ces questions sont encore les miennes »[3], dit-elle. La communication passe par le corps en équilibre instable, en train de se chercher : le corps, le toucher et la danse.
Une fine ligne dessine leurs bras qui s’enlacent et se balancent nonchalamment. Ils composent un ensemble minutieusement chorégraphié autour de la question de la conjugalité. « Ils-elles sont dans une danse à deux, une sorte de ritournelle, explique l’artiste, mais avec une forme d’abandon, comme un évanouissement. Les personnes dansent sur la pointe des pieds, tout le temps, elles sont en déséquilibre…». Une situation inconfortable dans des tentatives renouvelées de faire couple, faire communauté, faire relation… Comment vivre ensemble ? Comment « faire commun » avec nos vulnérabilités ?
Ces danseurs constamment sur la pointe des pieds évoluent comme aux rythmes syncopés du Bigidi des Antilles et du Maloya à La Réunion. Ce sont des danses « au bord de la chute » dit-elle, et qui, dans cette expérience du déséquilibre constant, expriment des manières d’être et de percevoir le monde spécifiques, peut-être moins normatives ou dogmatiques. « Dans le Bigidi, on est sur le point de tomber, on se rattrape à chaque fois, c’est une expérience d’être dans ce déséquilibre constant et peut-être que c’est aussi ça qui apporte de la force » dit-elle. Ce dont des danses qu’elle relie à « l’expérience du gouffre », image employée par Glissant pour désigner la cale du bateau négrier et l’enfer obsédant de la déportation, la faille originelle. Myriam Omar Awadi y fait référence dans un long dialogue avec Yohann Quëland de Saint-Pern intitulé « Ce qui nous tient éveillé.e.s », et publié en 2021 dans la revue AFRIKADAA[4].
L’artiste propose dans cette œuvre « une tentative d’incarnation du vivre ensemble », de la difficile conjugalité en prise avec les carcans sociaux et domestiques, une métaphore des relations humaines et de la complexité des relations amoureuses (What is love ? Baby don’t hurt me, don’t hurt me, no more[5]). « Le sentiment amoureux n’est-il que l’expression de ma nature biologique ? L’amour est-ce ce sentiment qui remplit de joie un individu en raison d’une cause extérieure ? (…) Ou l’amour n’est-il pas simplement le masque psychologique d’une réalité pulsionnelle sous-jacente et tirant son origine dans l’inconscient ? »[6].
Elle amène également, dans l’idée du déséquilibre comme moteur pour tenter de rester debout, une métaphore de la condition de l’artiste.
« FLEUR BLEUE, ÊTRE SENTIMENTALE », L’INSIGNIFIANCE COMME PRINCIPE ACTIF
« Note bleue – Coulée douce » date de 2010, et fait partie du corpus des Fleurs Bleues (2008-2018) incluant des dessins et des œuvres que Myriam Omar Awadi nomme des « In(actes) » et qui prennent également la forme de vidéos et de performances. L’artiste a déployé ce corpus au cours d’une résidence de création à l’Artothèque du Département en 2012. Celle-ci a donné lieu à une restitution au Musée Léon Dierx en 2013 puis une édition d’artiste portée par le laboratoire API de l’ESA Réunion en 2014 intitulée « Fleur bleue, être sentimentale. La visite guidée. Esthétique de la broderie ».
Le propos du corpus des Fleurs Bleues prend son origine dans la trajectoire de la jeune artiste alors qu’elle étudiait à l’école des Beaux-Arts à Brest. Son travail suscite à ce moment-là beaucoup d’incompréhension chez ses professeurs : ses propositions inspirées et nourries de sa culture comorienne ne sont appréhendées par ces derniers que dans les dimensions esthétiques qui les relient à l’art occidental, et notamment l’histoire de la performance. Toute la richesse de l’héritage comorien était perçu comme de la tradition ou du folklore et non comme expression artistique. Cette invalidation de son travail intervient comme une rupture dans son parcours, une expérience douloureuse qui la conduit à opérer, lors d’une année sabbatique, un détour vers une recherche sur les gestes traditionnels du tissage et de la broderie. « Je me suis rendue compte dit-elle, que ce qui m’intéressait au fond c’était toute la puissance des concepts et des métaphores que contiennent ces pratiques artisanales ». Ces préoccupations viendront ensuite nourrir son DNSEP à l’Ecole d’Art de la Réunion, avec une exploration du tissage de matières vivantes (fleurs de frangipaniers, graines germées) sous la houlette de Madame Zo, mais aussi un approfondissement de sa pratique performative avec des clés référentielles comme les démarches d’Ana Mendieta, Myriam Mihindou et Colette Pounia.
Ses pratiques de la broderie deviennent très vite le support d’une réflexion sur les questions de la valeur de l’art, des codes et des rituels qui prévalent dans le champ de l’art contemporain. « Pour moi, explique l’artiste, « Fleur bleue », c’était une ruse. J’utilise des références occidentales pour parler de mon travail et j’analyse le milieu de l’art tel qu’il est puisqu’on me dit que ce que je fabrique intuitivement, sincèrement, ça n’est pas de l’art »[7]. L’expression populaire « Fleur bleue », qui a une connotation péjorative, s’inspire de la locution « cultiver, aimer la petite fleur bleue »[8] et désigne un sentimentalisme empreint de naïveté, dans le registre de l’amour et du romantisme. Le motif de la fleur est, dit-elle un « dessin maladroit et obsessionnel » qu’elle compare aux divagations graphiques qu’il nous arrive de faire lorsque nous sommes au téléphone, un stylo à la main. Pratiques insignifiantes et motifs populaires au cœur d’une performance, d’un dessin, d’une vidéo, les In(actes) proposent ainsi des temps suspendus ou étirés, focalisés sur le geste de broder, de fumer, de dessiner des petites fleurs bleues, ou dans des actions où l’artiste, en pyjama, pose immobile dans sa buanderie ou sa cuisine. Dans ces tentatives de « faire meuble », réminiscence consciente du corps-objet de la période sombre de l’esclavage, elle interroge sa place en tant que femme à l’intérieur du foyer, dans une sorte de plaidoyer statique contre les systèmes d’enfermement des corps dans des assignations sociales et domestiques.
Le travail de Myriam Omar Awadi postule à l’instar de Cornélius Castoriadis, que l’insignifiance, qui est au départ synonyme de trivialité, sans importance ou d’une grande banalité, peut constituer un principe actif, un « mode de pensée, de perception et d’action particulier à l’œuvre dans une société »[9]. A la fois acte et négation de l’acte, les (In)actes (I, II, III…) se construisent sur l’idée d’inventaire « des choses qu’il faut faire pour ne rien faire ». (In)acte VI/broder consiste à recouvrir de petites fleurs bleues le drap d’un lit. Attachée aux sens multiples que revêtent les objets et les actes, MOA joue avec les mots, et prend le geste de broder également dans sa deuxième acception, qui est « l’enjolivement de faits ayant peu de contenance ». Les fleurs bleues de son installation parlent un double langage : celui teinté de maladresse, de naïveté voire d’idiotie que le sens commun assigne à l’expression “fleur bleue” et celui moins connu, donné à l’origine par le poète allemand Novalis, dans son grand roman inachevé, “Henri d’Ofterdingen”.
A travers ses vidéos et ses performances, l’artiste propose, selon ses propres mots, une « poétique de l’inaction, marquée par ces petits riens qui font le quotidien de tout un chacun, ces vides et ces gestes rituels qui rythment nos journées ». « J’aime beaucoup, dit-elle, les petites actions absurdes et discrètes de Jiri Kovanda, (…) et des trucs de grand-mère (vêtements, vaisselles aux motifs floraux) issus de pratiques artisanales telles que la broderie et la couture »[10]. Elle ajoute à cela les notes de chevet de Seï Shonagon en littérature, les « Touch poems » de Yoko Ono et les textes brodés de Louise Bourgeois, se référant à une de ses citations au sujet des tapisseries anciennes : « c’est l’envers qui vous dit la vérité »[11].
Myriam Omar Awadi est également très inspirée par la littérature : l’univers de Beckett, Perec, ou encore Kundera, particulièrement pour « La Lenteur », la Pénélope d’Homère[12], mais aussi Bartleby, personnage d’Hermann Melville qui, au départ travailleur consciencieux, choisit de passer son temps à regarder par la fenêtre du bureau plutôt que de faire son travail de script, répétant à son employeur, un homme de loi new-yorkais, « I would prefer not to ». « J’aimerais mieux ne pas… », une attitude de l’évitement et de la fuite, posée non pas comme acte de défection, mais comme arme « anti-pouvoir » et stratégie de lutte.
Convoquer l’insignifiance pour mettre en relief ces problématiques des discours et les enjeux esthétiques autour des œuvres est éloquent. L’art contemporain, en tant que paradigme, s’est justement mis en place sur la déconstruction progressive du sens et des principes qui définissaient l’œuvre d’art. Un refus délibéré de la qualité artistique et parfois même de la qualité esthétique, qui témoigne, selon Jean-François Mattéi, « de la tentation nihiliste qui taraude de façon continue l’art contemporain »[13].
PAROLES PAROLES, ENCORE DES PAROLES… DES MOTS MAGIQUES, DES MOTS TACTIQUES
Avec son travail autour de la broderie, ce sont également les pratiques de discours sur et autour des œuvres d’art qu’elle visite. Elle propose un art qui, dans une dimension « méta », questionne l’art et son fonctionnement, et plus spécifiquement « les modes de communication et de transmission rattachés aux sciences de la médiation culturelle », qu’elle relie à « l’art de la rhétorique et à celui plus noble et plus précieux (…) de la broderie »[14]. Dans la performance « Esthétique de la broderie, la visite guidée »[15], le contexte lui-même devient le support de la broderie « à savoir l’institution culturelle et les moyens qu’elle met en œuvre pour diffuser la création contemporaine ». « La principale matière de cette broderie parallèle est donc le verbe, la parole. Une parole qui enjolive, romance, exagère, invente ; une parole qui imite avec poésie, humour et peut-être même avec une pointe d’effronterie les modes de discours conventionnels »[16].
Myriam Omar Awadi prolonge ce travail autour de la parole et des pratiques du discours (amoureux, scientifique, esthétique, politique…), dans un atelier de recherche création (ARC), intitulé « Paroles Paroles », à l’Ecole Supérieure d’Art de La Réunion en 2016, en collaboration avec Yohann Quëland de Saint-Pern. Dans cet atelier sont passés bon nombre de jeunes artistes du territoire. Ce projet collaboratif se déploie désormais dans un des laboratoires du collectif La Box, qui interroge les modalité de ré-appropriation, de ré-activation et de ré-incarnation de la parole, dans ses dimensions institutionnelle et politique, théorique, poétique, engagée etc.
Le titre « Paroles Paroles », emprunté à la chanteuse Dalida, est doublement signifiant : il convoque une forme d’art populaire —la chanson sentimentale de variété, pour activer une œuvre performative. Il renvoie également aux « limites d’un discours amoureux usé » aussi bien qu’à la puissance des mots. La parole qui informe ou qui déforme, la parole qui enfle en rumeur et ladi-lafé, la parole donnée et reprise, la bonne parole prêchée et la bénédiction accordée, la parole qui guérit et celle qui tue, la malédiction, la parole qui tranche et fait tomber le couperet. Celle du début de toute chose. La parole partagée du dialogue. Le dialogue qu’on refuse par colère ou par confort, pour protéger ses intimes convictions, pour ne pas perdre la face. Le dialogue qui peut arrêter les guerres…
« Dans la chanson, écrit Myriam Omar Awadi, les paroles de Dalida (…) soutiennent au fond l’idée plus générale que l’expression verbale est aussi un mode de manipulation et de mystification du réel ». « Parler c’est un peu sale ajoute-elle, citant Deleuze[17], c’est sale, parce que c’est faire du charme, et Bourdieu rappelle qu’en tant qu’instrument de communication, la langue est aussi un signe extérieur de richesse et donc un instrument de pouvoir. Il y a des langues dominantes et d’autres dominées »[18].
Cette pensée et cette poésie de la parole et des pratiques du discours habite un corpus important d’installations performatives et de conférences performées. Orchestre Vide – Karaoké de la Pensée et Variétés[19] en collaboration avec Nicolas Givran et Yohann Quëland de Saint-Pern, The artist is shining : ces oeuvresont été montrées notamment à l’Ecole Supérieure d’Art, la Cité des Arts à Saint-Denis, dans le cadre de la programmation off de la FIAC, au Salon du livre d’art des Afriques, à La Colonie Barrée, en collaboration avec la revue AFRIKADAA en 2017 à Paris, ainsi qu’à la 12e édition des Rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie en 2019. Une préoccupation qui irrigue également avec beaucoup de bonheur quelques démarches d’artistes de la jeune génération issue de l’Ecole Supérieure d’Art, comme Sonia Charbonneau, avec Running Zone notamment, ou Brandon Gercara et ses Lipstick de la pensée.
La démarche de Myriam Omar Awadi s’inscrit dans le creuset artistique et activiste qui interroge les règles du monde de l’art contemporain en train de germer et de prendre racine à La Réunion à la fin du XXème siècle : Quels discours valident quelles œuvres, selon quels critères, et à destination de quels publics ? Quelle culture ? Exister pour qui ? Quels codes, quels rituels, quels enjeux économiques et symboliques ?
L’artiste met en scène la performativité du discours sur l’art —c’est à dire sa capacité à réaliser ce qu’il énonce. Elle propose ainsi une mise en perspective des stratégies institutionnelles qu’a décrit Rainer Rochlitz[20] : certaines œuvres sont choisies parce qu’elles sont importantes, et parfois elles deviennent importantes parce qu’elle sont choisies, dans une forme de « prophétie auto-réalisatrice ».
La question des regards et des discours portés sur les pratiques artistiques des Suds, auxquelles a longtemps été refusé le pouvoir de faire sens dans le champ d’une esthétique occidentale qui s’arrogeait l’exclusivité de l’universalité, prend une acuité nouvelle à la lumière des luttes contre toutes les formes de domination : coloniale, féministe, environnementale… « Parfois, écrit Myriam Omar Awadi, la meilleure posture alliée, c’est de se mettre en retrait et de laisser faire celleux qui sont directement concernée.x.s. Nous ne sommes pas des sujets d’études et nous pouvons œuvrer par nous-mêmes »[22].
Myriam Omar Awadi propose de déconstruire les mécanismes de domination, par un positionnement situé, c’est-à-dire conscient de ce qu’il véhicule de représentations, d’images, de symboles, de désirs, de pouvoir réel ou supposé, à fortiori dans des territoires anciennement colonisés. Embrasser, avec humilité, la complexité des situations permet d’éviter les écueils des conclusions simplistes et de réduire la symphonie du monde à une plate et déceptive « parole contre parole ».
Interrogeant, comme l’écrit Leila Quillacq, « les manières d’habiter les vides et de démonter le spectacle, de faire choir ce qui fascine pour revenir à ce qui mord »[23], Myriam Omar Awadi propose non plus d’attaquer le monde, mais bien de l’embrasser… « par une chanson d’amour ».
Patricia de Bollivier
2024
[1] Myriam Omar Awadi, « Fleur bleue, être sentimentale. La visite guidée. Esthétique de la broderie », ESA Réunion, 2014, p.48.
[2] Id. p. 46.
[3] Myriam Omar Awadi, propos recueillis par P. de Bollivier, le 19/10/2023.
[4] Myriam Omar Awadi et Yohann Quëland de Saint-Pern, « Ce qui nous tient éveillé.e.s », AFRIKADAA n°14, pp 174-180, 2021.
[5] What is love, Haddaway, 1993, cité par Myriam Omar Awadi dans « Fleur bleue, être sentimentale. La visite guidée. Esthétique de la broderie », ESA Réunion, 2014, p.17-18.
[6] Myriam Omar Awadi, id. p. 18-19.
[7] Myriam Omar Awadi, propos recueillis par P. de Bollivier, le 19/10/2023.
[8] Myriam Omar Awadi, « Fleur bleue, être sentimentale. La visite guidée », ESA Réunion, 2014, p. 10.
[9] Castoriadis, Cornelius (1996): La montée de l’insignifiance. Paris: Seuil.
[10] Propos recueillis par P. de Bollivier, catalogue d’exposition « LUMIÈRE, peinture, photographie, vidéo », Centre d’arts visuels et collection d’art contemporain de la ville de Saint-Pierre, 2013, p. 6.
[11] « Tissée, tendue au fil des jours, la toile de Louise Bourgeois » de Jacqueline Caux
https://www.babelio.com/livres/Caux-Tissee-tendue-au-fil-des-jours-la- toile-de-Louise-/231670
[12] Qu’elle découvre et étudie dans l’ouvrage « Le chant de Pénélope, poétique du tissage féminin dans l’odyssée » de Ioanna Papodopoulou Belmedhi, éditions Belin, 1994.
[13] Jean-François MATTEI– CONFÉRENCE « L’art de l’insignifiance ou la mort de l’art » – Cannes 2004 https://www.artefilosofia.com/lart-de-linsignifiance-ou-la-mort-de-lart/
[14] Myriam Omar Awadi, « Fleur bleue, être sentimentale. La visite guidée », ESA Réunion, 2014, p. 53.
[15] avec Nicolas Givran, en 2012. Co-production Artothèque.
[16] Myriam Omar Awadi, citée dans le dossier Document D’Artiste La Réunion.
[17] Gilles Deleuze, la culture, in L’Abécédaire, éd. Montparnasse, 2004.
[18] texte de présentation du laboratoire « Paroles Paroles », https://www.laboxproject.com/paroles-paroles
[19] Orchestre Vide – Karaoké de la Pensée et Variétés en collaboration avec Nicolas Givran et Yohann Quëland de Saint-Pern, The artist is shining : oeuvres montrées notamment à l’Ecole Supérieure d’Art, la Cité des Arts à Saint-Denis, dans le cadre de la programmation off de la FIAC, Salon du livre d’art des Afriques, La Colonie Barrée, en collaboration avec la revue AFRIKADAA en 2017 à Paris, ainsi qu’à la 12e édition des Rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie en 2019
[20] Rainer Rochlitz, « Subvention et subversion, art contemporain et argumentation esthétique », Gallimard, 1994, p. 175-176.
[21] Yves Michaud, « Art, politique, pouvoir », in P.-P. Droit, éd., « L’art est-t-il une connaissance ? », Le Monde éditions, 1993, p. 312. Cité par Rainer Rochlitz, id. p. 175.
[22] Myriam Omar Awadi, texte inédit, 2023. Elle cite Afrikadaa, n°14, « Les révoltes silencieuses », p. 22 : « Nous ne voulons plus être vos sujets d’études ».
[23] Leila Quillacq, Document d’Artiste La Réunion, 2020.